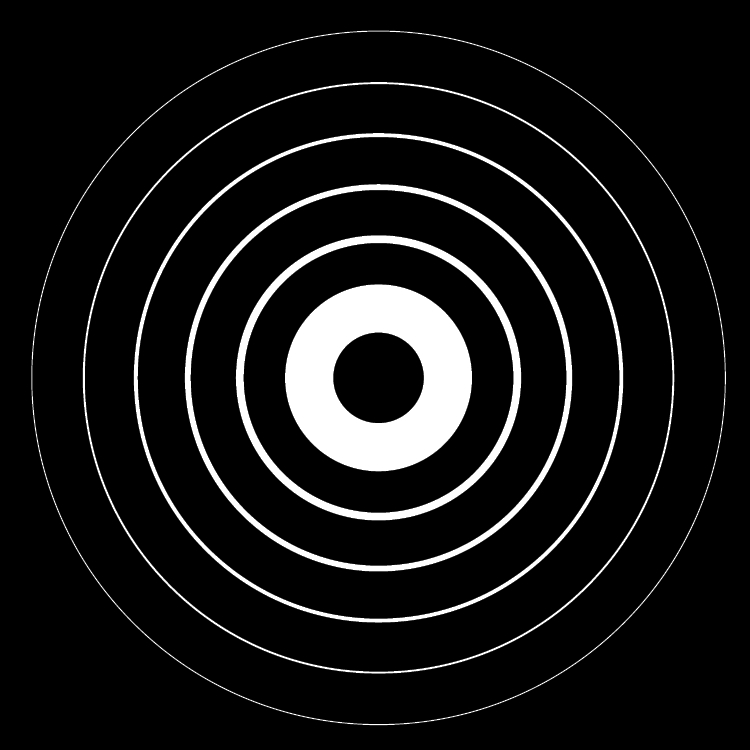ROUGE virtuose - Programme du concert
Johannes BRAHMS, Concerto pour violon en ré maj. op. 77 (1878)
Johannes Brahms écrit son Concerto pour violon au cours de l’été 1878 à Pörtschach, sur les rives d’un petit lac, au contact d’une nature qu’il chérit, en plein cœur de l’Empire Austro-Hongrois ; il le dédie à Josef Joachim, l’ami violoniste très proche, connu dans sa jeunesse. Rencontre décisive, car c’est aussi sur les conseils du musicien que le jeune Brahms se rend pour la première fois en 1853 à Düsseldorf chez les Schumann. Admis dans l’intimité du couple, c’est le début d’une amitié durable et d’un éblouissement réciproque ; la rencontre avec Robert Schumann lui ouvre bien des portes, dont celles du grand éditeur Härtel, installé à Leipzig. Quant à la relation particulière qu’il noue avec Clara, mélange de fascination, d’amitié et d’amour, elle le marquera tout au long de sa vie et nourrira son travail d’artiste : « Il n’y a qu’à Madame Schumann que je sois dédié cœur et âme », dira Brahms ; elle le lui rend bien et, alors que la nature de leurs échanges reste teintée de mystère, on la sait d’une fidélité sans faille au jeune compositeur, notamment dans ses interprétations de ses œuvres pour piano.
Le Concerto pour violon en ré majeur op.77 – Allegro ma non troppo, Adagio, Allegro giocoso, ma non troppo vivace – est-il le fruit d’une collaboration entre Joachim et le compositeur ? Probablement. Plus familier de l’écriture pianistique, Brahms réajuste à plusieurs reprises son oeuvre, réputée d’une extrême difficulté, aux côtés du violoniste, dont on souligne les origines hongroises. Le résultat est immédiat et populaire ; l’hommage aux instrumentistes tziganes avéré, notamment dans le finale.
Créé par Joachim, avec l’orchestre du Gewandhaus sous la direction de Brahms lui-même le 1er janvier 1879, il est joué dans la foulée plusieurs fois en Europe. La structure de l’oeuvre respecte le schéma originel du concerto baroque ; et l’on passe de mouvements enjoué puis recueilli à fougueux. Brahms, fidèle aux maîtres du passé, poursuit le sillage de ses prédécesseurs et contemporains. Pour rappel, Beethoven a livré auparavant son Concerto pour violon en ré majeur op.61 ; on pense également aux concertos pour violon de Mendelssohn ou à celui toujours en ré majeur de Tchaikovsky. Ré majeur, le ton a été dans l’histoire de la musique commenté avec précision : « joyeux et très guerrier » selon Marc-Antoine Charpentier, ou tel un « chant d’allégresse et de reconnaissance » pour Jean-Philippe Rameau, il est sans doute le plus aisé aux doigts du violoniste.
Le concerto oscille entre joie et poésie, et répond à une esthétique romantique exaltée. Le violon se fait l’acteur virtuose et expressif qui nous arrache tantôt les larmes, tantôt quelques pas de danse… Après une page introductive magistrale, l’orchestre dans sa richesse symphonique se soumet, attentif, au violon, le soutenant, le consolant ou en accentuant la liesse populaire.
Aurélie Vinatier
Dmitri Chostakovitch, Symphonie n°11, « L’année 1905 », en sol mineur, op. 103 (1957)
1 – Adagio, « La place du palais »
2 – Allegro, « Le 9 janvier »
3 – Adagio, « Mémoire éternelle »
4 – Allegro non troppo, « Le Tocsin »
Lorsqu’il se retire à l’été 1957 à Komarovo, près de Léningrad, pour achever l’écriture de sa Onzième symphonie, Dmitri Chostakovitch est à nouveau en délicatesse avec le pouvoir. Après le scandale en 1936 de l’opéra Lady Macbeth de Mzensk, qualifié par le pouvoir de « galimatias musical », et la censure de sa Quatrième symphonie, lui ayant valu une première angoissante et douloureuse mise à l’index, il avait échappé de peu à la déportation – si ce n’est à la mort – durant la Grande terreur en 1937, puis avait été renvoyé de son poste de professeur au conservatoire de Leningrad en 1948.
La création de sa Dixième symphonie en décembre 1953, quelques mois après la mort de Staline, l’avait à nouveau conduit à comparaître devant l’omnipotente Union des compositeurs soviétiques, déjà responsable de sa condamnation de 1948. Au cours de trois longues journées de discussions difficiles, Chostakovitch avait été sommé de justifier ses choix de compositeur et de se livrer à une violente autocritique, face à l’accusation réitérée de « formalisme bourgeois » portée contre lui.
Si les premiers effets de la déstalinisation se font sentir en 1957 avec l’allègement de la chape de plomb que la doctrine Jdanov faisait peser sur la création artistique, l’URSS n’est pas pour autant devenue libérale, et la répression violente que son pays inflige aux révolutionnaires hongrois de 1956 affecte profondément le compositeur, déjà fragilisé par la disparition en 1954 de Nina Varzar, sa première épouse.
Dans un tel contexte, le choix n’est pas anodin d’évoquer, dans une œuvre supposée célébrer le quarantième anniversaire de la révolution d’Octobre et commandée à cette occasion, les victimes (plusieurs milliers sans doute) de la fusillade du 9 janvier 1905. Ce jour-là, un cortège de plus de 200 000 ouvriers de Saint-Pétersbourg, accompagnés de leurs familles et de nombreux enfants, s’était dirigé vers le Palais d’hiver, avec l’intention d’adresser à Nicolas II une pétition exposant leur misère et demandant une série de réformes politiques et de justice sociale. Alors même que le Tsar était absent, l’armée d’un pouvoir aux abois avait pourtant ouvert le feu sur la foule.
S’il satisfait en apparence aux codes esthético-idéologiques du réalisme socialiste, y intégrant de nombreux thèmes de chants révolutionnaires familiers aux oreilles du public soviétique des années 1950, Chostakovitch les passe au filtre blafard d’une ironie grinçante et désespérée. Et si l’œuvre est couronnée d’un hypocrite prix Lénine en 1958, marquant un nouveau retour en grâce du compositeur, elle ne fait guère illusion auprès des auditeurs : la poète Anna Akhmatova, ayant assisté à la création de l’œuvre, évoque ces chants révolutionnaires comme des « oiseaux blancs volant contre un ciel terriblement noir ». Le compositeur lui-même aurait affirmé au musicologue Solomon Volkov qu’il fallait y entendre la voix d’un « peuple ayant perdu la foi, la coupe du mal ayant fini par déborder ». Mstislav Rostropovitch enfin, en parle comme d’une « symphonie écrite avec du sang ».
Les quatre mouvements de l’œuvre, enchainés à la manière d’un monumental poème symphonique construit autour du motif initial exposé aux timbales, se concentrent sur l’effraction violente de la fusillade, dans une paisible journée d’hiver. L’atmosphère crépusculaire du premier mouvement naît de la superposition des accords de cordes divisées, avec sourdines, dont la sonorité volontairement fragile n’hésite pas devant les dissonances, et des appels lointains de cuivres et de percussions, évoquant l’armée qui, sur la place du palais, se prépare au massacre. Une flûte énonce un premier chant, repris aux trompettes, comme une tentative de faire reculer cette ambiance pesante, mais le froid glacial du lugubre hiver pétersbourgeois gagne peu à peu la foule assemblée.
C’est alors que se produit le drame. Le tourbillon obsessionnel de cordes de plus en plus agitées évoque la manifestation débouchant sur la place du palais : l’attente se mue en impatience, l’excitation s’enfièvre, tandis qu’aux bois, le chœur des demandes de la foule se fait chant choral, alors que peu à peu, elle s’immobilise, nue, face aux fusils pointés. L’instant, tout en suspens, est soudain déchiré par un feu nourri, d’une violence à couper le souffle, dont ne pourront plus émerger que stupeur et désolation.
L’enfance de Chostakovitch, dans une famille socialiste descendant d’un révolutionnaire polonais déporté en Sibérie, avait été bercée des récits de cette journée dramatique ayant précédé de peu sa naissance, et certaines scènes semblent l’avoir fortement marqué, notamment les monceaux de cadavres d’enfants évacués, entassés sur des traîneaux, qu’il évoque dans ses Mémoires.
Cœur vibrant et éploré de la symphonie, le troisième mouvement est un long chant funèbre de déploration des morts. Confiant au doux pupitre des altos le « Chant des martyrs », incontournable des obsèques officielles en URSS mais qui reprend ici toute sa charge émotionnelle, Chostakovitch propose un moment de recueillement, entre gravité et tendresse, avant de sonner le tocsin appelant à la révolte lorsque s’engage le quatrième mouvement. Le chant « Enragez, tyrans » puis le thème de « La Varsovienne » mué en martial appel de cordes emportent l’orchestre dans un mouvement frénétique que vient interrompre un cor anglais presque surnaturel, brève respiration avant le retour du tocsin, sonné à la volée par de terribles et implacables cloches.
Loin de la musique officielle et guindée à laquelle cette profusion d’hymnes révolutionnaires aurait pu conduire un compositeur moins libre, Chostakovitch, en leur insufflant l’acerbe et mordante ironie dont il est coutumier, tourne le dos à l’hypocrite et vain terrain miné de la politique, offrant à un monde qui n’était pas entièrement prêt à l’entendre un discours de morale et d’humaine vérité. Son écriture en tension permanente (il y a toujours, pour l’instrumentiste, une note de trop dans la liaison, un intervalle de trop dans des aigus intentionnellement malingres ou trop puissants, un doigté nécessairement malaisé, une dissonance plus aigre que douce) met le corps du musicien dans l’inconfort, la contraction, instillant le malaise et rendant presque palpable la contrainte. Il est impossible de jouer cette musique totalement librement… Là où Brahms est élan de vie permanent, Chostakovitch est une poitrine oppressée cherchant de l’air.
Fanny Layani
Le chant des martyrs
Vous êtes tombés pour tous ceux qui ont faim,
Tous ceux qu’on méprise et opprime,
De votre pitié pour vos frères humains,
Martyrs et victimes sublimes.
Mais l’heure a sonné et le peuple vainqueur
S’étire, respire, prospère.
Adieu, camarades, adieu, nobles cœurs,
Adieu, les plus nobles des frères.
Pour prix de vos peines, la peine de mort,
Ou bien la prison pour la vie,
Du bruit de vos chaînes sont pleines encore
Les plaines de Sibérie.
Guillaume CHILEMME, violon

Premier Prix du Swedish International Duo Competition avec le pianiste Nathanaël Gouin, et troisième Grand Prix ainsi que Prix spécial des élèves des conservatoires de Paris au concours international Marguerite Long – Jacques Thibaud, Guillaume Chilemme figure parmi les violonistes les plus reconnus de sa génération. Il forme depuis de nombreuses années un duo avec son ami Nathanaël Gouin.
Guillaume Chilemme est membre du quatuor Renaud Capuçon avec Edgar Moreau et Adrien Lamarca, ils se produisent régulièrement dans le monde entier.
Depuis 2016, Guillaume Chilemme est le violon solo de l’Orchestre d’Auvergne. Il est fréquemment invité en tant que violon solo dans divers orchestres (lʼOrchestre de Paris, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Radio France, le Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Barcelone, l’Orchestre Gulbenkian de Lisbonne, La Camerata de Salzbourg…)
Guillaume Chilemme se produit régulièrement en tant que soliste, il est notamment invité par l’Orchestre du Capitole de Toulouse sous la baguette de Tugan Sokhiev, l’Orchestre Victor Hugo Besançon Franche-Comté, l’ensemble Les Dissonances, l’Orchestre National de Bretagne, lʼOrchestre National dʼAuvergne…
En 2020, il crée aux côtés de Matthieu Handtschoewercker, Thomas Duran et David Gaillard le Quatuor Dutilleux.
Il enseigne au sein de lʼInternational Menuhin Music Academy (Suisse).
Guillaume Chilemme est lauréat de la fondation Safran (2015) et joue un violon de Yair Hod Fainas, ainsi qu’un archet de Delphine Petitjean.
Andrei FEHER, direction

Le chef d’orchestre canado-roumain Andrei Feher s’est bâti une réputation grâce à sa maturité musicale, son intégrité et son autorité naturelle sur le podium.
Après avoir acquis une première expérience en tant qu’assistant de Fabien Gabel à l’Orchestre Symphonique de Québec, Andrei Feher rejoint à l’âge de 22 ans l’Orchestre de Paris en tant que chef adjoint de son directeur musical, Paavo Järvi. Il a collaboré avec certains des interprètes les plus éminents d’aujourd’hui, dont Emanuel Ax, Marc André Hamelin et Erin Wall.
Andrei Feher apparaît régulièrement comme chef invité avec les meilleurs orchestres canadiens et européens, notamment le Symphony Nova Scotia, le Scottish Chamber Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Québec, Les Violons du Roy et l’Orchestre National d’Île de France.
En 2018, à 26 ans, il est nommé directeur musical de l’Orchestre symphonique de Kitchener-Waterloo, faisant de lui l’un des plus jeunes à diriger un grand orchestre canadien.
Violoniste accompli, il a étudié à l’école Joseph-François-Perrault et s’est formé à la direction d’orchestre au Conservatoire de Montréal, avec Johanne Arel et Raffi Armenian.
Il vit aujourd’hui à Montréal avec sa femme et ses deux jeunes fils.